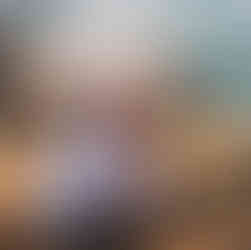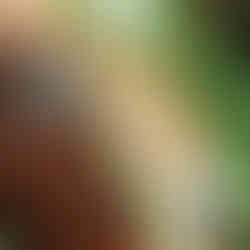Mersea People & Wild Youth : l’art en réponse au vague à l’âme.
- 1 août 2025
- 26 min de lecture
Chez Dorothée Henriot, l’art jaillit comme un élan vital — une nécessité intérieure, une manière de traverser la vie sans en fuir l’intensité. C’est un souffle, une pulsation intérieure, une façon d’exister sans filtre, sans fard. Chaque trait qu’elle trace, chaque mot qu’elle écrit, naît d’un trop-plein d’émotion qu’elle refuse de taire — qu’elle transforme, inlassablement, en beauté brute. Dans une première partie d’interview, elle se raconte à travers ses racines bretonnes, la mer comme guide et mémoire, le deuil comme faille fondatrice, la maternité comme terre nouvelle, et cette hypersensibilité qui innerve chacun de ses gestes. Mersea People, c’est elle, à chaque battement : un univers sensible, peuplé de visages, de rituels intimes et de silences habités. Une philosophie vivante, plus qu’une marque. Une œuvre de soi, profondément incarnée.
Puis vient le second souffle, celui de la rencontre. Le récit s’ouvre pour accueillir Chloé Eucher, photographe du sensible, révélatrice d’éclats et de frissons. Sœur d’âme artistique, elle entre dans l’histoire comme on entre dans un lieu sacré — avec justesse, douceur, pudeur et fulgurance. Ensemble, elles tissent une œuvre à quatre mains, portée par l’instinct et une forme rare d’harmonie intuitive. Une amitié où l’on se devine sans se parler, où la création devient un langage commun, brut et limpide.
À elles deux, elles rappellent que l’art n’est pas un produit : c’est une présence. C’est ce qui les maintient à flot. Ce qui les relie aux autres. Ce qui les empêche de s’éteindre. Une manière d’habiter le monde autrement, de ralentir, de ressentir, de se relier. Un espace où l’émotion prend corps, où la vulnérabilité devient force. Car tant qu’il y aura des gestes à poser, des formes à inventer, des mots à libérer, elles continueront — à créer, à vibrer, à vivre.
Pour répondre, toujours, à ce que le monde laisse parfois en creux : le vague à l’âme.

Culture is the New Black : Tu as grandi entre Quiberon et l’île de Houat, bercée par l’océan. Quels souvenirs te reste-t-il de cette enfance ?
Dorothée Henriot : J’ai le souvenir d’une enfance très libre — c’est d’ailleurs ce que je souhaitais offrir à mon enfant, et c’est le cas aujourd’hui. Je garde en tête l’image d’une enfance idyllique en bord de mer, rythmée par de longues journées de plage, des ramassages de coquillages… Des choses simples, assez classiques quand on part en vacances à la mer — sauf que moi, c’était mon quotidien. C’était une enfance joyeuse, et surtout très créative. J’étais tout le temps dans mon monde, à inventer, à créer avec tout ce que je trouvais autour de moi. J’éprouvais aussi un vrai besoin de raconter. Je n’en garde pas beaucoup de souvenirs conscients, mais ma mère me l’a souvent décrit : j’aimais raconter mes vacances avec des objets ramassés sur la plage. Il y avait déjà ce besoin de mise en forme, de narration. Ce goût pour la liberté, il est resté.
CNB : Tu rends souvent hommage à des personnes de ta famille, notamment des pêcheurs. Qu’est-ce qu’ils t’ont transmis ?
Dorothée Henriot : Ma mère est houataise, elle est née sur l’île. Toute ma famille maternelle a grandi là-bas, et ils y vivent encore aujourd’hui. Ma mère est la benjamine de la fratrie, et comme elle m’a eue assez tard, mes oncles et tantes sont aujourd’hui très âgés. Ils habitent toujours à Houat, et ils ont presque tous été pêcheurs. C’est eux qui m’ont transmis le respect profond de la vie maritime. Ils ont une existence très simple, et un amour presque viscéral pour l’océan. Encore aujourd’hui, ils vivent à travers lui. Ils racontent leurs récits de pêche avec une passion incroyable. Enfant, je passais mes journées à les écouter raconter leurs épopées maritimes. Je me revois autour de la table, à les écouter au retour de la pêche, pendant qu’on mangeait ce qu’ils avaient ramené…
Ils ont toujours eu un immense respect pour l’océan, et pour ce qui nous nourrit. La devise de Houat, c’est « De la mer nous vivons » — une phrase qui résume parfaitement ce qu’ils m’ont transmis. Il y a aussi une grande dimension spirituelle dans leur manière de vivre : ils sont très croyants, ce qui est très lié à leur métier. Chez eux, la religion et la mer sont intimement mêlées. D’un regard extérieur, c’est presque un univers artistique. Je ne suis pas croyante, mais la manière dont ils vivent leur foi chrétienne me touche profondément. Pour moi, ce n’est pas tant une question de religion que de tradition. Il y a quelque chose de sacré et ça me parle. L’église de Houat est magnifique. Ces lieux de recueillement, je ne les relie pas forcément à une foi religieuse, mais plutôt à une mémoire, à une émotion transmise. J’aime l’idée qu’on puisse y aller juste parce qu’on trouve ça beau et parce qu’on en ressent la dimension sacrée. C’est très présent dans mes souvenirs d’enfance. Ma tante joue de l’orgue à l’église, donc tout un imaginaire s’est construit autour de ça pour moi. Les traditions bretonnes aussi, très fortes : je me souviens de ma grand-mère qui parlait breton et qui, chaque matin, prenait son temps à mettre sa coiffe et à enrouler sa longue tresse. J’ai des souvenirs très photographiques de tout ça. Je la revois se coiffer devant son petit miroir doré, orné de la Vierge Marie. Je pourrais en faire des tableaux !
CNB : Qu’est-ce que la mer t’a appris sur toi-même ?
Dorothée Henriot : La mer, pour moi, c’est quelque chose de très introspectif. Je passe beaucoup de temps à marcher, à aller voir le coucher du soleil… C’est un moment méditatif. La mer te ramène à la valeur du temps. C’est un rendez-vous, un moment suspendu où tu choisis de t’arrêter, de ralentir, et de prendre conscience que le temps passe. Elle m’apaise aussi énormément, parce que je suis quelqu’un d’assez hyperactive, qui a besoin de remplir ses journées, de les nourrir intensément. Alors commencer ma journée par une balade jusqu’à la mer, c’est devenu un rituel essentiel. C’est un moment de calme, presque un miroir. Un espace pour me retrouver.
CNB : Le dessin et la peinture t'ont accompagnée très tôt. Tu as toujours eu un crayon à la main… Qu’est-ce qui t’a transmis cet amour pour l’art ? On parlait d’art à la maison ?
Dorothée Henriot : Mon père aimait l’art et les artistes, mais je l’ai découvert plus tard. En ce qui concerne le dessin et la peinture, c’est quelque chose qui vient vraiment de moi. C’est profondément ancré, comme un langage, un moyen de communication que j’ai eu dès la naissance. Personne autour de moi ne me l’a transmis, il n’y a pas eu de mimétisme. C’est d’ailleurs l’inverse de ce que je vis aujourd’hui avec ma fille : elle me voit dessiner, créer, et elle reproduit mes gestes. Elle est déjà très habile avec un crayon. Mais moi, enfant, c’était un rapport totalement instinctif. Je dessinais sans influence directe — simplement parce que j’en avais besoin.
CNB : Comment décrirais-tu cette relation entre le geste du dessin et ton monde intérieur quand tu étais petite ?
Dorothée Henriot : J’étais une petite fille traversée par beaucoup d’angoisses et de questionnements. Je me posais énormément de questions sur mon rapport au monde, au point que ma mère disait que j’avais « le vertige du ciel et des étoiles ». J’avais un trop-plein intérieur, quelque chose qui devait sortir. Plus tard, j’ai compris que j’étais hypersensible — ce qui explique ce besoin de traduire ce que je ressentais par le dessin. Naturellement, quand on est enfant, on dessine parce qu’on ne sait pas encore écrire. L’écriture est venue plus tard pour moi, je l’utilise beaucoup aujourd’hui, mais à l’époque, c’est le dessin qui m’a permis de m’exprimer. J’avais besoin d’un exutoire, car mes angoisses étaient très présentes. Tous les enfants en ont, bien sûr, mais chez moi, c’était très marqué. La peur de la mort, par exemple, est arrivée très tôt. Et comme j’étais souvent seule, j’étais déjà dans mon monde intérieur. Le dessin, puis la peinture, sont venus comme des langages à part entière, comme des outils pour exprimer et apprivoiser ce que je ressentais profondément.
CNB : Dès toute petite, tu semblais déjà avoir une patte bien à toi, très reconnaissable. Tu avais déjà cette manière de donner des visages à des éléments, des émotions aux choses, des caractères à la mer ou au vent… Est-ce que tu te souviens de tes premiers dessins "habités", où le monde prenait forme comme un théâtre d’âmes ?
Dorothée Henriot : J’ai toujours dessiné des personnes. Ma mère me racontait que je dessinais aussi souvent des mains. Je ne me souviens pas de mon tout premier dessin, mais elle en a gardé un : un Pierrot la Lune que j’ai fait à l’âge de six ans. Il avait de grands yeux, et j’avais décidé de brûler les bords de la feuille… J’avais déjà ma patte, je savais ce que je voulais artistiquement [rires]. Je dessinais partout, tout le temps — même sur les murs ! C’était vraiment un plaisir. Je me souviens que les gens étaient souvent impressionnés. Je sentais que j’avais quelque chose d’un peu différent. En maternelle, j’avais peint une grande fresque représentant une maman qui pousse un enfant. L’école a gardé ce dessin très longtemps — si bien que, bien plus tard, au lycée, je me souviens être repassée devant et l’avoir vu encore accroché. Je crois que j’ai toujours su que je dessinerais. Je ne me suis jamais vraiment posé la question de mon parcours : c’était une évidence. Je savais que ce serait mon métier.
CNB : Aujourd’hui encore, tu personnifies beaucoup les éléments. Tu représentes souvent la mer comme une entité vivante, presque humaine – parfois féminine, parfois mystérieuse, parfois blessée. Peux-tu nous parler de cette personnification ? Est-ce que la mer, pour toi, est un personnage, une présence, une mère, une amie ?
Dorothée Henriot : Je crée tout le temps des personnages et je raconte des histoires. Ça vient sûrement de l’enfance. La mer, pour moi, c’est comme une personne. Quand je surfe ou que je suis dans l’eau, je ressens une présence — j’ai la sensation de ne pas être seule. On oublie trop souvent que les éléments sont vivants. C’est pour ça que je les personnifie : pour rappeler qu’il faut les respecter, parce qu’ils sont eux aussi des êtres vivants. On a tendance à oublier à quel point l’être humain est petit face à tout ça. Et là encore, on revient à cette idée du "vertige du ciel". Par exemple, Alice au pays des merveilles est l’un de mes Disney préférés, justement parce qu’il reflète mon monde : un monde où tout est personnifié.
© Mersea People
CNB : On ressent cette vraie sincérité émotionnelle dans ton travail, parfois même brutale. Est-ce important pour toi de ne pas "adoucir" ce que tu ressens quand tu crées ?
Dorothée Henriot : Je ne le cérébralise pas. D’ailleurs, en te parlant, je prends conscience de certaines choses, mais quand je crée, je ne mets aucun filtre. De manière générale, je ne m’en mets pas — même dans ma façon de m’exprimer sur les réseaux sociaux. Je fais les choses simplement, naturellement. Je dis ce que j’ai à dire comme j’aime le dire, sans stratégie derrière. Quand certaines personnes pensent qu’il y a une forme de marketing dans ma manière de communiquer, ça me fait doucement rire. Je suis très sincère, et c’est aussi pour ça que j’ai choisi cette vie-là. Je n’ai pas envie de tricher. Mersea People, c’est à mon image. C’est une extension de moi et de mon art. Et j’ai envie de rester fidèle à mes valeurs, profondément honnête. Je ne suis pas là pour vendre des choses, simplement. Ce n’est pas ça, le sens.
CNB : Tu as quitté Quiberon pour partir en études à Nantes et ensuite t’installer dans le Pays basque, où tu travailles comme graphiste chez Roxy. Comment s’est fait ce tournant professionnel ?
Dorothée Henriot : Dans ma famille, j’ai toujours été un peu l’OVNI, parce que mes parents n’étaient pas du tout dans un milieu artistique. Ça a été difficile, parce que tu te retrouves constamment à devoir prouver que tu peux vivre de ton art — encore aujourd’hui, d’ailleurs. Être artiste, ce n’est pas rassurant pour des parents. Quand il a fallu choisir un parcours après le bac, je voulais faire les Beaux-Arts ou du dessin animé. J’ai passé plein de concours, et j’ai été acceptée, notamment aux Gobelins à Paris. Mais je ne me sentais pas prête à vivre à Paris. Alors je me suis dit : "Je vais faire une école supérieure d’arts graphiques, quelque chose de plus concret pour rassurer mes parents." Je savais que je ne pouvais pas m’épanouir pleinement, mais c’était un compromis. Dans cette école, j’aimais les cours de dessin, mais tout le reste m’ennuyait profondément.
À l’époque, j’étais avec quelqu’un qui faisait beaucoup de surf, et il était attiré par le Sud-Ouest. Moi aussi, j’étais fascinée par cette image un peu cliché du surf là-bas. J’ai commencé à me renseigner et j’y suis allée au culot. J’ai envoyé des demandes de stage, sans prétention, et j’ai été prise chez Billabong. A l’époque, Roxy m’avait dit qu’ils ne prenaient pas de stagiaires, mais qu’ils me rappelleraient si un poste se libérait. Un jour, alors que j’étais caissière au Leclerc de Capbreton, la directrice artistique de Roxy m’a recontactée. Elle m’a proposé un poste de designer graphique. La veille j’étais caissière, le lendemain j’étais graphiste ! [rires] Mon travail consistait à dessiner des robes, des imprimés, des broderies sur les tee-shirts… En fait, ce que je fais aujourd’hui pour moi, je le faisais pour Roxy. Une fois que tu entres dans le cercle de l’industrie du surf, tout fonctionne au bouche-à-oreille. J’ai travaillé trois ans chez eux, puis chez Billabong, DC Shoes, et d’autres. Pendant dix ans, j’ai fait des "sauts de puce" entre différentes boîtes du Sud-Ouest. Et puis un jour, j’en ai eu assez. Alors j’ai créé Mersea People.
CNB : C’est justement à cette période, en 2015, que tu traverses une épreuve personnelle très douloureuse. C’est là que naît Mersea People. Peux-tu nous parler de cette transition, à la fois brutale et fondatrice ?
Dorothée Henriot : Mon père est tombé malade quand j’avais 24 ans, à une période où j’avais justement arrêté de travailler chez Roxy. Ça a été un premier coup dur. À ce moment-là, j’ai décidé de partir en voyage à l’autre bout du monde. Mon père était un grand voyageur, et c’est lui qui m’a encouragé à le faire. Son cancer semblait stabilisé, donc je suis partie. Mais une fois là-bas, son état s’est aggravé. Je suis rentrée pour m’occuper de lui jusqu’à la fin. Ensuite, je suis retournée dans le Sud-Ouest, et là, c’était la déferlante : un deuil non fait, une relation amoureuse compliquée… Une situation bancale qui m’a fait comprendre que rien n’allait. Trois ans après le décès de mon père, tout m’est retombé dessus. J’étais complètement perdue. Je faisais beaucoup d’allers-retours à Quiberon, mais je ne me sentais bien ni là-bas, ni dans le Sud-Ouest. J’étais dans un entre-deux, comme inachevée. Avec du recul, je réalise que je n’étais pas perdue — j’étais simplement sur un autre chemin. Il y a un livre que je lis à ma fille en ce moment qui m’a beaucoup touchée : un petit garçon demande à son papa "Et si je suis perdu ?", ce dernier lui répond "Si tu es perdu, c’est juste un autre chemin." Ça m’émeut profondément, parce que c’est exactement ce que j’ai vécu. On n’est jamais vraiment perdu·e. On est en transition.
A ce moment-là, j’ai rencontré ma meilleure amie, Hinatea, qui traversait elle aussi une période de transition. Elle m’a aidée à prendre conscience de la valeur de mon talent. Elle m’a poussée à arrêter de créer pour les autres, et à commencer à créer pour moi. Elle m’a donné l’élan dont j’avais besoin. J’avais cette idée en tête depuis longtemps, mais je manquais de force, et de confiance en moi. À l’époque, j’avais un blog sur lequel je publiais mes dessins et j’écrivais beaucoup. J’avais une petite communauté bienveillante qui me suivait. Le nom "Mersea People" est venu très naturellement. J’avais beaucoup de gratitude pour eux, et pour la force qu’ils m’envoyaient. Je me suis lancée… et ça fait maintenant dix ans !
CNB : Le nom « Mersea People » est chargé de symboles – un jeu entre "merci", "mer", "sea", et "people". Que représente ce nom pour toi aujourd’hui ?
Dorothée Henriot : Au début, j’avais pensé à un nom breton : Da ma Hael, qui signifie « À mes anges ». Il y avait derrière cette idée une forme de remerciement, de gratitude. Mais je me suis dit que c’était trop personnel — et j’avais envie de quelque chose de plus universel. Le premier mot qui m’est venu ensuite, c’est merci. À ce moment-là, Hinatea était elle aussi en train de créer sa marque. Je me revois assise en face d’elle, en train de lui parler de ce qui m’inspire profondément : la mer. Le jeu de mots est venu ensuite, très naturellement. Au départ, je voulais simplement Mersea, mais c’est aussi le nom d’une île, donc ce n’était pas possible légalement. J’ai ensuite pensé à Mersea les gens, mais ça ne sonnait pas comme je le voulais… Et puis Mersea People m’est apparu. C’était ça. C’était évident.
CNB : Avec Mersea People, tu ne te limites pas à la toile : céramique, textile, illustration, objets du quotidien… ton art s’exprime sur une multitude de supports. Rien n’est figé, chaque pièce semble porter une énergie brute, presque instinctive. Qu’est-ce qui guide ton choix du support, et comment naît une création chez toi ?
Dorothée Henriot : Au début, tout était très instinctif. C’étaient des envies, des élans. Je suis quelqu’un qui part un peu dans tous les sens et j’avais envie que Mersea People me ressemble, que ce soit à mon image. Je voulais que ce soit populaire — dans le sens noble du terme — parce que l’art est souvent élitiste. Moi, je voulais créer des pièces uniques, mais accessibles, que tout le monde puisse s’offrir. Dès la première collection, il y avait les médaillons en porcelaine, parce que j’aimais leur côté précieux. Je voulais créer des œuvres d’art miniatures, comme des petits talismans. Ils rappelaient les coquillages qu’on porte sur une chaîne en souvenir des vacances. Dès le début, je savais que je voulais faire de la céramique. C’est la mère d’un ami qui m’a initiée à la porcelaine. Elle faisait des essais de couleurs sur des petites pièces, et moi, j’ai eu envie de les transformer en médaillons. J’étais extrêmement fière de mes premiers — ce qui est rare chez moi. Pour les dessins, je me suis naturellement tournée vers le textile, parce que j’avais travaillé dans ce domaine. Je connaissais bien les techniques, les matières, les impressions. J’aimais l’idée que les gens puissent s’offrir un vêtement comme on s’offre un souvenir — une sorte de madeleine de Proust version t-shirt, comme ceux qu’on achète en vacances avec le nom de la destination. Ce que je voulais, c’était offrir de l’art à tout le monde. Rendre la création accessible, sans perdre sa poésie.

CNB : Comment sais-tu, à un moment donné, si ce que tu ressens doit devenir une forme, un trait, une couleur, un bijou ? Est-ce que c’est l’émotion qui dicte la matière, ou la matière qui t’amène à l’émotion ?
Dorothée Henriot : Parfois, c’est le support qui m’inspire le dessin. Par exemple, pour les prochaines vareuses que je vais sortir, j’avais en tête un visuel très précis à placer dans le dos — et c’est vraiment le vêtement qui m’a soufflé ce dessin-là. De manière générale, il n’y a pas de règle, je fonctionne avec beaucoup de liberté. Pour autant, je demande souvent l’avis des personnes qui m’entourent. J’ai des idées en tête, mais j’ai aussi besoin d’être rassurée en permanence — et je trouve ça sain. Ça me ramène à une forme d’humilité, qui est très importante pour moi. J’ai besoin des autres pour exister. Je ne crée pas seule dans une bulle fermée — j’avance aussi grâce aux regards que je choisis de laisser entrer.
CNB : Ton travail est profondément traversé par l’émotion, que tu assumes sans détour en évoquant ton hypersensibilité. Il y a dans ce que tu crées une sincérité brute, parfois presque à vif. Aujourd’hui, on voit de plus en plus d’artistes revendiquer leur vulnérabilité, là où cela a longtemps été caricaturé comme un "cliché d’artiste torturé". Pourquoi est-ce important pour toi d’en parler ouvertement ?
Dorothée Henriot : Je pense qu’on devient artiste parce qu’on est hypersensible — et qu’on se reconnaît entre nous. Il y a une forme de compréhension mutuelle. Par exemple, mon conjoint ne l’est pas, et parfois je dois lui rappeler ce que ça veut dire vraiment. Être hypersensible, ce n’est pas juste pleurer devant une pub de céréales : c’est être hypersensible aux bruits, aux odeurs, aux énergies... C’est quelque chose qu’on vit au quotidien. Aujourd’hui, j’en parle plus ouvertement parce que je n’ai pas envie que ce soit vu comme une faiblesse. Au contraire, pour moi, ça a toujours été une force. Je me revois encore, enfant, quand mon père me disait : "Arrête de pleurer." Mais aujourd’hui, si j’ai envie de pleurer, je pleure. Pourquoi devrais-je cacher une émotion qui me traverse ? Il faut que ça sorte. Et c’est précisément ce qui nourrit mon art. Si je n’étais pas hypersensible, je n’aurais sans doute pas fait tout ce que j’ai fait. C’est aussi pour ça que j’ai eu envie de le dire. Je n’aurais pas accès à autant de ressources intérieures. Parfois, on me demande comment je fais pour me renouveler, pour créer sans arrêt. La réponse est simple : je grandis, je vieillis, donc je traverse de nouveaux états, de nouvelles émotions — et tout ça me pousse à dire de nouvelles choses. Je pense que ça ne s’arrêtera jamais, parce que j’aurai toujours quelque chose à dire… et je ne vais pas me taire ! [rires] Aujourd’hui, j’ai 40 ans et avec cet âge arrive une nouvelle envie : celle de la transmission. J’ai toujours aimé créer du lien, apprendre des jeunes comme des moins jeunes, rester dans l’humilité.
Aujourd’hui, j’ai envie de transmettre l’envie de partir à la rencontre de soi. Explorez-vous ! Explorez tous les sentiments qui vous traversent, et essayez de les traduire comme vous pouvez ! Je le dis souvent : fais de tes sentiments ta matière. On a tous une palette de sentiments différente, à chacun de trouver comment la traduire. On est tous des artistes. Ce qui change, c’est la capacité à traduire ce qu’on ressent. L’introspection fait l’artiste. C’est elle qui nous oblige à faire face à ce qu’il y a à l’intérieur de nous. Tous ces sentiments deviennent concrets à travers l’art. Et c’est ça qui me bouleverse quand je reçois certains messages : des gens me disent que j’ai réussi à mettre des mots, ou des images, sur ce qu’ils vivaient. Quand on me dit ça, je me dis que j’ai réussi et que je ne vais pas m’arrêter là. Mais c’est vrai aussi que ce n’est pas toujours facile. Parce que dévoiler ses émotions, c’est aussi se mettre à nu, aux yeux de tout le monde.
CNB : Tu es très directe sur Instagram, tu parles sans filtre à celles et ceux qui te suivent. Est-ce une nécessité pour toi de briser le quatrième mur entre artiste et audience ?
Dorothée Henriot : En réalité, je n’ai jamais vraiment ressenti cette barrière. Pour moi, il n’y a pas de mur entre les gens. Je pense que ma façon de communiquer peut parfois surprendre ou déstabiliser, et je le comprends. Mais je me mets quand même des filtres, parce que je pourrais être encore plus cash ! La bienséance me pousse à doser un peu. Je crois qu’il faut arrêter de trop se prendre au sérieux, de se construire des petits trônes là où il n’y a pas lieu d’en avoir. Alors j’essaie simplement d’être moi. À la base, mon compte Instagram était mon compte perso, et j’ai continué à communiquer dessus naturellement. Du coup, l’audience que j’ai aujourd’hui, je ne la perçois pas vraiment comme réelle. Ce n’est pas quelque chose de palpable pour moi. Parfois, ça me joue des tours, parce que je n’en ai pas toujours conscience. Je vis ici, sur mon bout de caillou, dans mon quotidien, avec les mêmes personnes autour de moi. Je suis dans une sorte de huis clos. Les 50 000 personnes qui me suivent, ils suivent cette vie simple, ici, à Quiberon. Comme je ne me rends pas compte de l’ampleur, je partage les choses très naturellement : si j’ai envie de dire que je suis allée me balader, je le dis. En revanche, je fais attention à certaines choses : par respect pour celles et ceux qui me suivent, je ne vais pas partager mes soirées entre amis, par exemple. Il y a une forme de pudeur et de respect dans ce que je choisis de montrer.
Aujourd’hui, certaines personnes viennent jusqu’à Quiberon pour découvrir mes créations, et ça me touche profondément. Petit à petit, je prends conscience de la valeur de cette audience — mais ce n’est pas pour autant que je vais ériger une distance. Mon compte Instagram reste la vitrine de ce que je suis, et de ce que je fais. Rien de plus, rien de moins.
CNB : Sur ton compte Instagram, tu rappelles souvent que tu es seule derrière Mersea People, sans usine, sans équipe, sans stock automatisé. Tu parles d’indulgence, d’humanité, de lenteur créative. Pourquoi est-ce essentiel pour toi de poser ce cadre de réalité ?
Dorothée Henriot : C’est aussi pour ça que je tiens à rester très vraie — pour rappeler qu’il y a un être humain derrière. On n’est que deux : la personne qui gère le studio, et moi. Et ça ne changera pas. Plein de fois, j’ai eu envie de faire grandir le projet mais à chaque fois que je me perds un peu dans ces envies de grandeur, je reprends le carnet dans lequel j’avais écrit, au tout début, ce que je voulais pour Mersea People. Et je me rappelle que mon objectif, c’était simplement de vivre de mon art, sans me perdre en chemin. C’est très difficile de rester fidèle à soi quand ça commence à marcher, parce que l’envie d’aller plus loin, de faire plus, est très présente. Mais vouloir "plus", ça veut aussi dire entrer dans une logique de marketing, de production, d’industrialisation. Produire plus pour gagner plus — ce n’est pas ce que je veux. Alors, oui, ça m’oblige souvent à répéter que je suis seule, que je fais tout, et que je veux que ça reste comme ça. On me demande parfois : "Pourquoi tu ne délègues pas ?". Mais si je faisais faire… ce ne serait plus moi qui ferais. Tout simplement. Je veux tout faire moi-même. Et ça, ça ne changera pas.
CNB : Est-ce aussi une manière de rappeler l’importance de la place de l’artiste et de son art, unique et non aseptisé ?
Dorothée Henriot : Oui ! Le problème, c’est que c’est un peu le serpent qui se mord la queue. Les gens veulent une pièce unique, mais sont frustrés quand il n’y en a pas toujours. Pourtant, si je ne faisais pas tout moi-même, ces pièces n’auraient pas la même valeur, et peut-être qu’on n’aurait même plus envie de les acheter… Je reste solide sur mes appuis. Ce que je veux, c’est vivre ici, simplement. Pouvoir m’offrir des voyages, offrir ce que je peux à ma fille. Je n’ai pas l’appât du gain. L’argent ne me motive pas. Je me suis toujours fiée à moi-même. Mais j’ai aussi énormément de gratitude envers les gens qui me suivent, qui me soutiennent et qui me nourrissent par leurs retours. Sans eux, je ne pourrais pas vivre de ma passion. C’est un cercle vertueux.
CNB : Tu le disais, tu es devenue maman d’une petite fille, Bonnie-Angèle. Quelle place tient la maternité dans ton parcours d’artiste aujourd’hui ?
Dorothée Henriot : La maternité a changé ma façon de dessiner ! Mon trait est devenu plus rond, plus coloré. Aujourd’hui, je pense beaucoup à elle quand je crée. Comme de nouveaux sentiments sont apparus en moi, forcément, ça nourrit ce que je fais. J’ai envie qu’elle soit fière, que ce soit encore plus beau, plus doux. La maternité a aussi transformé mon audience : les personnes qui me suivent depuis le début ont évolué avec moi. Je suis souvent étonnée — et touchée — de voir qu’il y a aussi beaucoup de très jeunes qui me suivent. Ça me rend heureuse, parce que je trouve ça génial de pouvoir toucher plusieurs générations. La maternité est un nouveau chapitre qui me donne envie d’écrire et de dire de nouvelles choses !
CNB : Quel rapport est-ce que tu as avec l’écriture justement ?
Dorothée Henriot : J’ai toujours aimé écrire. J’aime accompagner mes illustrations avec des mots, parce que je trouve que c’est un autre vecteur de communication. Une autre manière de toucher. J’aime jouer avec les mots. Je ne suis pas une grande lectrice, je n’ai pas de références littéraires précises, mais j’aime poétiser un peu tout. C’est ma façon d’apporter une nuance, une respiration, une émotion en plus.
Dorothée Henriot et Chloé Eucher : “Nous sommes des âmes sœurs artistiques”.
CNB : Depuis quelque temps, tu travailles en lien très fort avec Chloé, qui t’accompagne non seulement dans la communication de Mersea People, mais aussi dans l’écoute, le regard, le rythme du projet. Chloé est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment s’est faite la rencontre entre vous deux ?
Chloé Eucher : Je m’appelle Chloé Eucher, je suis photographe et j’ai 27 ans. J’ai rencontré Dothy grâce à ma meilleure amie, Julia, qui habite à Quiberon. J’y venais souvent quelques jours pour lui rendre visite, et un jour, je me suis prise de passion pour le surf — alors même que je déteste le pratiquer ! [rires] Pourtant, je trouve que c’est un sport magnifique à observer et à capturer. J’ai commencé à prendre des photos d’amis de Julia, et Dothy est tombée dessus. Elle a demandé à Julia qui les avait prises, et c’est comme ça qu’on est entrées en contact. J’étais très fière, parce que j’aimais énormément ce qu’elle dégageait. Pendant le confinement, elle m’a demandé si elle pouvait dessiner sur certaines de mes photos. J’ai accepté tout de suite. On a commencé comme ça, à distance. Et puis après le confinement, en 2020, elle m’a proposé qu’on fasse des photos et vidéos ensemble. La première fois qu’on s’est retrouvées sur la plage, Dothy était tellement stressée qu’elle avait vidé une bouteille de cidre en solo ! [rires] On aurait cru un date. Le coup de foudre a été immédiat. Alors qu’on ne s’était jamais vues, je lui ai raconté toute ma vie. On a parlé pendant des heures, on a fait nos premières photos… et tout est parti de là.
Dorothée Henriot : Je revois le moment… C’était à la plage du Moulins. On a matché direct !
CNB : Qu’est-ce que ça fait de photographier, de traduire ou de porter la voix d’une amie ? Est-ce que cette proximité facilite la création… ou rend certaines choses plus délicates à dire ou à montrer ?
Chloé Eucher : Pour moi, Dothy est devenue comme de la famille. Elle m’a rappelée un jour en me disant que si elle devait faire entrer quelqu’un dans le studio, ce serait moi. À cette période-là, je n’allais pas très bien. Je faisais beaucoup de crises d’angoisse… et elle m’a littéralement remonté la tête hors de l’eau. Je n’ai jamais fait de différence entre l’amie et l’artiste. C’est une personne qui est devenue comme une sœur, et j’avais envie de traduire ses émotions. On partage les mêmes vibrations : les sentiments, la tristesse, la mélancolie… J’avais envie de raconter ce qu’elle ressentait, et je crois qu’on a réussi à créer exactement ce qu’on voulait.
Dorothée Henriot : On est des âmes sœurs artistiques ! Toutes nos photos, on les fait en vingt minutes, à peine. Parce qu’on sait. On se connaît.
CNB : Est-ce qu’il faut comprendre que vous travaillez avec une forme d’intuition partagée, de langage invisible entre vous ?
Dorothée Henriot : En général, je lui parle de ce sur quoi je travaille, de ce que j’ai envie de raconter, et très vite, ses idées fusent. Ce qu’il faut savoir, c’est que lorsque Chloé est derrière son appareil photo, elle se transforme. Dans la vie, elle est plutôt timide, discrète, douce… mais dès qu’elle photographie, elle devient très directive. Elle sait exactement ce qu’elle veut. Elle te met en confiance, elle t’amène là où elle veut t’emmener, et c’est toujours juste, toujours sublime. Il n’y a qu’avec elle que je suis aussi à l’aise. Et ça, dès le début, sans même vraiment se connaître.
Chloé Eucher : Il y a eu une alchimie immédiate. Ça arrive parfois avec certaines personnes. Je suis très spirituelle, et je crois que certaines âmes se reconnaissent d’avant. Avec Dothy, j’en suis convaincue. Que ce soit dans l’art ou dans nos vies, on se rejoint sur beaucoup de choses. Même physiquement, on nous demande souvent si on est de la même famille ! C’est fou de rencontrer quelqu’un qui représente 50 % de toi. J’ai toujours dit à Dothy que, quand les gens regardent mes photos ou mes vidéos, je veux qu’ils pleurent, qu’ils ressentent quelque chose, qu’ils aient des frissons. Pour que ça marche, il faut choisir les bonnes choses : les bonnes personnes, les bonnes musiques. Et avec elle, tout s’aligne naturellement.
CNB : Chloé, tu sembles attirée par des projets sensibles, artisanaux, presque "fragiles" au sens beau du terme. Qu’est-ce que tu souhaites montrer avec ce type de création ?
Chloé Eucher : J’ai toujours été attirée par l’univers du rêve et des émotions. Ce que j’aime, c’est faire ressentir quelque chose. Je n’ai pas envie qu’on oublie ce que je fais. J’ai besoin que mon art laisse une trace, qu’il soit marquant. La musique est aussi un levier important pour moi. Elle accompagne mes images, elle leur donne une autre dimension, et elle m’aide à me démarquer. Mes parents m’ont transmis une grande culture musicale. J’en écoute tous les jours, c’est une partie essentielle de ma vie. La musique provoque des frissons – et c’est exactement ce que je cherche à transmettre à travers mes photos. Je veux que les gens ressentent quelque chose de fort. Je ne suis pas là juste pour prendre des images : je veux raconter une histoire.
CNB : Cette volonté de transmettre des émotions fortes, de créer une empreinte, on la retrouve aussi dans la façon dont vous vous impliquez localement. Que ce soit à travers les tee-shirts dessinés par Dorothée pour certains restaurants, ou les images que Chloé réalise pour mettre en lumière les artisans du coin… Qu’est-ce que cela signifie pour vous de nourrir ces liens de proximité à travers vos créations ?
Dorothée Henriot : Il n’y a pas de plus grande fierté que ça pour moi. Il ne faut pas oublier qui étaient là au début. Même si j’avais 1 million d’abonnés, ce sont eux que je croise au quotidien et qui font partie de ma vie. C’est très important pour moi de bien reçevoir les gens d’ici et d’être poli avec eux. C’est une vraie fierté !
Chloé Eucher : D’autant que les gens ici sont très fédérateurs et n’hésitent jamais à féliciter notre travail. Quand je suis arrivée à Quiberon, j’avais peur de ne pas m’intégrer, surtout sur une presqu’île. A l’inverse, j’ai beaucoup de gratitude car j’ai été très bien accueillie !
CNB : Dorothée, qu’est-ce que Chloé a su capter ou révéler de toi que d’autres ne voyaient pas ?
Dorothée Henriot : Ma sensibilité, ça c’est sûr ! Tout est plus beau dans ses yeux. Elle m’impressionne à chaque fois. Quand on est ensemble, c’est un véritable ping-pong d’idées. Chloé apporte une lumière incroyable à ce que je fais. Elle est très talentueuse, mais elle a surtout ce petit quelque chose en plus. Tout le monde peut tenir un appareil photo entre ses mains, mais peu savent capturer des images qui touchent profondément. On peut tous être devant le même coucher de soleil — pourtant personne ne prendra la même photo. Chloé est celle qui trouve l’instant juste, la lumière exacte. Elle ne prend pas une photo, elle prend la photo. Elle a aussi une culture musicale dingue. Grâce à elle, j’ai compris à quel point la musique pouvait être un moteur d’inspiration, alors que de mon côté, j’écoute surtout des podcasts quand je crée. Chloé a un regard sur mon univers que personne d’autre n’a. Moi, je vois ce que je fais de l’intérieur, je suis dans mon vortex créatif. Elle, elle perçoit ce que les autres ne voient pas. Je la laisse entrer dans mon intimité de création — elle est là dans tous les moments, les plus heureux comme les plus durs. Elle sait tout de moi, et elle a cette envie sincère de traduire ça, pour que tout le monde puisse le ressentir.
CNB : Toutes les deux, vous évoquez cette idée de mise à nu à travers votre travail, confrontée à la fois à la pudeur et parfois à un manque de confiance. Comment trouvez-vous l’équilibre entre cette exposition de soi et la fragilité qu’elle implique ?
Dorothée Henriot : Chloé est très pudique — encore plus que moi. Et paradoxalement, elle est à cœur ouvert dans son travail. Si tu sais la lire, tu peux percevoir son humeur à travers ses photos. Tu sens immédiatement si elle va bien ou non. Moi, je le vois directement dans ce qu’elle partage, dans ce qu’elle transmet : ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur. Nous sommes un peu comme des artistes qui enfilent un costume. L’art devient ce costume-là. Ce n’est pas nous à nu, pas tout à fait. Il y a une forme de pudeur dans nos émotions. On ne veut pas forcément tout livrer de façon frontale, alors on dissimule dans notre art. Je partage beaucoup, mais il y a des émotions que je garde précieusement pour moi, et que je choisis finalement de déposer dans mon art. Il y a plein de facettes qui composent notre palette artistique, et ce n’est pas toujours simple de trouver le bon équilibre. Parfois, on aurait envie de se dévoiler encore plus, mais sans tomber dans la sur-exposition ou la banalisation des sentiments. Il y a une forme de sauvagerie dans tout ça. Il faut savoir nous apprivoiser. Et nous deux, on s’est apprivoisées.
Chloé Eucher : De mon côté, je n’aime plus trop montrer mon visage sur les réseaux sociaux. Pourtant, mes vidéos racontent ma vie de manière subtile. Je traduis ce que je vis à travers ce que je produis.
CNB : Quels sont les projets communs qui vous attendent ?
Dorothée Henriot : On travaille depuis des mois sur une exposition autour de notre voyage à Hawaï, réalisé en novembre dernier. J’y étais invitée pour exposer mes créations, et j’ai proposé à Chloé de m’accompagner — c’était l’un de ses rêves. À notre retour, l’exposition aurait dû voir le jour bien plus tôt… Mais depuis la naissance de ma fille, c’est devenu très difficile de trouver du temps. Tout va plus vite. En réalité, deux choses freinent ce projet : ma fille mais aussi mon perfectionnisme, qui me pousse à procrastiner. J’ai écouté récemment un podcast sur ce phénomène : la procrastination liée au perfectionnisme. Cette tendance à ne jamais réussir à poser un point final… C’est exactement ce que je vis avec cette exposition.
L’exposition aura tout de même lieu à Quiberon, au studio. Elle mêlera photographies, vidéos et objets créés sur place. Ce voyage a été un vrai souffle pour moi. J’avais besoin d’un coup de frais. Après dix ans, j’avais cette sensation d’avoir fait le tour, de tourner en rond. Ce séjour m’a ressourcée en profondeur. L’exposition est prévue pour septembre. J’ai déjà tout griffonné dans mon carnet, et chez moi, c’est toujours bon signe : quand je commence à griffonner, c’est que ça va bientôt sortir ! [rires]
CNB : Chloé, pourrais-tu nous dire pourquoi tu photographies ?
Chloé Eucher : Je photographie pour que la vie ne s’efface pas. C’est très important pour moi de créer des souvenirs, parce qu’on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Je photographie pour traduire des émotions dans l’image, pour que l’on comprenne que la vie est magnifique, mais aussi terriblement précieuse. La valeur du temps est quelque chose de fondamental pour moi. J’ai envie que la mélancolie traverse mes photos, qu’elles fassent ressentir quelque chose.
CNB : Dorothée, pourquoi tu dessines, peint et crée ?
Dorothée Henriot : Parce que j’ai des choses à dire ! [rires] Parce que c’est vital. Parfois, je me dis que même si je perdais l’usage de ma main, je trouverais encore un moyen de dessiner. C’est une extension de moi. C’est ma façon de communiquer, ma thérapie, ma méditation. C’est moi. Je suis mon art.
À noter : Chloé Eucher exposera son travail photographique au Sofitel de Quiberon d’août à décembre 2025. Quant à l’exposition consacrée à leur voyage à Hawaï, elle verra le jour au studio Mersea People, à Quiberon, en septembre prochain — une plongée poétique entre terres volcaniques et récits intimes, où l’image et le geste dialoguent en liberté.
Instagram : @mersea_people et @wildyouth_film
© Chloé Eucher pour Mersea People
.png)